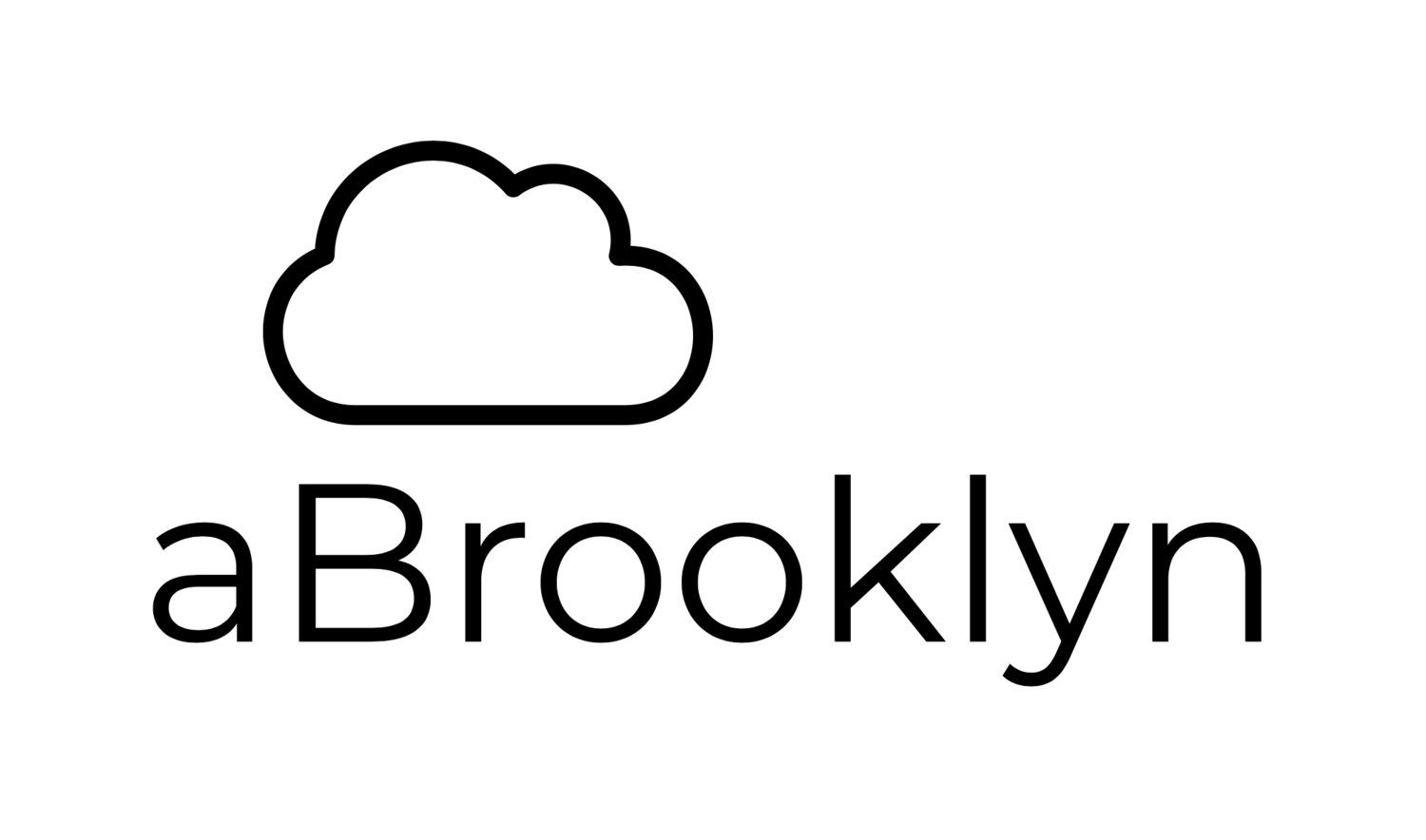NEW YORK
Quelques sensations ...
– Manhattan
Je n’aurais pas parié sur cette sensation. Mais comment aurait-il pu en être autrement puisqu’elle touche les gratte-ciel et donc Ground Zero, la grande blessure. On va vers elle sans le vouloir.
Down Town réveille la pétulante Petula Clark sur l’écran noir et blanc de nos vieux téléviseurs Thomson. On sourit et ça éclate dans la tête : “ Down Town ! ...” “Down Town” accompagne nos pas et soudain on se questionne. Que disait-elle la chanteuse blonde aux taches de rousseur et aux longs cils écarquillés ? Que pouvait-elle bien dire dans cette chanson ? Qu’est-ce qui a pu changer à Down Town depuis le temps ?
Prendre New York par le bas est amusant pour une ville qui voue un culte à la verticalité. Est-ce un hasard si dès le sud elle nous fait relever la tête ? Elle voudrait cacher ses dessous, elle ne s’y prendrait pas mieux. D’accord, on a mauvais esprit mais c’est la ville qui provoque.
Port maritime mais surtout fluvial, New York s’est donnée à voir au XIX ième siècle dans une folie de mâts : une première skyline flottante qui a dû mettre en condition l’inconscient des habitants et leur aspiration au gigantisme. Un port mais qui tourne le dos à l’idée d’être un havre.
Dans le piétinement des longues files d’attente à Ellis Island, les premiers migrants ont vécu la désillusion du refuge et d’un havre de grâce même si après de longues semaines de navigation, une maîtresse-femme, flambeau brandi, leur indiquait qu’ils touchaient le but.
Comment ne pas aborder Manhattan par le bas quand on sait que c’est là que New York est née, s’est battue pour exister, que sur ce bout de langue achetée une bouchée de pain aux indiens se tiennent la Battery et le taureau de Wall Street. Car c’est bien là, entre l’Hudson et l’East River que jaillit l’énergie de New York.
C’est ainsi qu’à Down Town le premier jour on se retrouve presque malgré soi à St Paul’s Chapel. Lieu de silence, de recueillement et d’hommage aux pompiers des familles orphelines. Dans la floraison blanche et rose des prunus - le may-blosson des new-yorkais - les yeux se lèvent vers Freedom Tower puis vers les autres tours du World Trade Center dont certaines sont en chantier ou en projet, toutes numérotées sur le papier de 1 à 7 comme les rues et les avenues de Manhattan.
Tête rejetée en arrière, on se perd, le regard s’égare, n’arrive plus à distinguer le bleu du ciel du bleu dans le verre qui en écho le réfracte. Lames érigées dans leur brillance métallique comme des couteaux bivalves aux reflets nacrés que sur une plage du Cotentin à marée basse un enfant aurait plantés et alignés dans le sable. L’épaisseur de ces lames semble infime. Il suffit de se déplacer de quelques centimètres pour que l’illusion cède : il y a une profondeur, ce sont des cubes mis les uns sur les autres : legos, dominos,pièces de mecchano, constructions d’enfants un soir de Noël dans l’oubli du temps.
Ces gratte-ciel sont des actes de foi. Une Sagra Familia outre-atlantique. Le sentiment d’écrasement des pérégrins au pied des édifices religieux. Regarde tout en haut. Elève-toi. Crois au miracle de l’Ascension. Les ascenseurs de M.Otis qui ont rendu possible la construction des gratte-ciel te font signe de monter. Faute de toucher le ciel, les skyscrapers captent, raptent la lumière, photographient le passage des nuages, expose aux anges les incidents de la voûte céleste. Les américains veulent s’accrocher au ciel comme d’autres décrocher la lune. Echec. Qu’à cela ne tienne, ils vont tout simplement faire descendre “le ciel des fixes” sur leurs buildings. Arrogance démentielle. Dans chaque new-yorkais un petit Icare sommeille qui rêve de Babel.
Le 11 septembre 2001 s’est déroulé dans le ciel de la métaphysique. L’américain a été touché à coeur : une attaque ontologique l’a fait vaciller jusqu’à ses racines qui ont résisté comme le montre ce bronze couleur rouille coulé dans le moule des racines restées intactes du sycomore, symbole de la protection divine de l’Amérique.
— Les New-Yorkais.
Ils vont sur le même trottoir, dans la même direction, regardent droit devant eux, visages impénétrables, semblent seuls dans leurs pensées sans donner l’impression de rêver. On ne les dirait pas vraiment préoccupés, plutôt absorbés par l’horizon qu’ils fixent.
Savent-ils où ils vont ? Pas sûrs qu’ils le sachent très bien. Mais ils y vont, avec leur pas, leur âge, leur état de santé très variable selon qu’ils habitent Midtown ou East Village, qu’ils reviennent de chez Tiffany’s où ils ont choisi un or ou de la soupe populaire distribuée à Tompkins Square Park. Ils vont dans le confort plus ou moins grand de leurs chaussures faites souvent pour la marche mais aussi pour certaines femmes dans l’inconfort de leurs escarpins qui cambrent leurs pieds perchés sur des talons si hauts et si fins que l’envie viendrait presque d’appeler ces escarpins des “ groundscrapers”. Ils vont donc sans traîner régler un problème dont ils entrevoient déjà la solution avant qu’un autre ne se présente à eux et les absorbe comme ils absorbent le monde dans leur marche.
Sont-ils différents des piétons de Paris, de Londres ou de Bruxelles ? Sans nul doute. De la fenêtre d’un hôtel de Chelsea on peut les voir marcher le matin, l’après-midi, mais aussi la nuit. Mais qu’y s’en étonne dans une ville qui s’auto-proclame “ the city that never sleeps” ? A la différence des français, ils ne fument pas en marchant et semblent trouver tout naturel que fumer soit interdit aux terrasses des bars et dans les jardins publics. En marchant, ils ne paraissent pas faire un usage immodéré de leurs téléphones portables ou de leurs tablettes électroniques. La plupart mangent en marchant, un hamburger bien souvent, dont la qualité là aussi dépend beaucoup du type de camion où il est acheté : ils n’ont pas le même goût provenant d’un food-truck sillonnant les rues de Lower Manhattan ou d’un camion ambulant garé dans l’Alphabet City.
Presque tous ont à la main un gobelet en carton percé d'une paille qu'ils portent à leurs lèvres régulièrement et les jeunes mères un nouveau-né à leur sein qu'elles initient en le nourrissant ainsi au plaisir du déplacement.
Rien ne paraît arrêter les new-yorkais dans leurs marches si ce n'est, au croisement des rues, des mains aux doigts écartés qui clignotent dans leur lumière blanche et semblent repousser le piéton du plus loin qu'il les voit clignoter; des mains qui clignotent en alternance avec le décompte des secondes qu'il reste au piéton pour traverser la rue avant le redémarrage des voitures au feu-vert. Signalétique étrange. Le choix d'une main qui repousse est-il vraiment judicieux ? Le décompte permanent du temps qui reste, censé faire l'économie du jugement : passer ou pas passer, à tout le moins le faciliter, n'est-il pas angoissant ? Car finalement, que vous dit-on ? « Maintenant tu n'as plus que cinq secondes pour traverser. A tes risques et périls. Tout à l'heure tu en avais quinze, c'était mieux tout de même. Eh bien oui, tu n'en décides pas, c'est ainsi, le temps passe. Il passe en te donnant le temps de traverser mais, en dehors de ton intention de traverser cette rue, il passe aussi le temps de ta vie; eh bien tu vois, à cette vitesse exactement, seconde par seconde. Au fait il t'en reste combien de secondes à vivre encore, combien de secondes pour traverser la vie comme cette rue, hein ? Combien ? Dis, tu réalises le temps qui passe ? En tout cas maintenant tu le visualises. »
Chaque rue traversée à New-York est un sablier.
Le choix de cette signalétique n'est pas anodin. On veut nous faire croire qu'il existe un temps objectif parfaitement mesurable. Or, seul compte pour l'homme le temps vécu qui est infiniment subjectif comme l'ont montré chacun à leur façon des Kant, des Bergson et des Proust. A quel réel veut-on nous ramener ? Mais je me trompe sans doute. Cette signalétique est là pour nous rappeler l'urgence de vivre, cette fureur qu'on retient. Oui, le temps nous est compté et il faut le saisir, ériger le ciel, l'espace, s'emplir du monde, du bruit des autres qui le scandent de manière hallucinante. Ambulances, polices, voitures de pompiers hurlent, geignent, miaulent à tous les carrefours et par des pitreries de clowns, dans un tohu-bohu de cirque, rappellent le cache-cache avec la mort. Sous les plaques grillagées des trottoirs les métros se ruent dans de sourds fracas. Quand on se croit à l'abri du bruit dans les parcs arborés qui longent l'Hudson face au New Jersey, qu'on se surprend à prêter l'oreille au chant des oiseaux, la noria des hélicoptères vrombissant pour les touristes qui veulent voir New-York par le haut nous ramène à la hachure du temps.
Mais là encore pourquoi s'étonner ? A un espace de papier millimétré hérissé de lignes il serait curieux que le temps en écho ne soit pas celui de l'anti-durée. On vous le hache menu, le temps. On administre aux new-yorkais des piqûres d'instants comme une nouvelle méthadone. Du coup le vertigineux gratte-ciel devient l'équivalent spatial d'un temps syncopé. En dépit de ses apparences éclatées le discontinuum urbain devient un continuum espace-temps harmonieux car dans l'âme la musique habite les new-yorkais. Les saxos ne sont jamais très loin à Washington Square Park. Dans la distorsion sonore des explorations jazzistiques des avant-garde du Stone, cette toute petite salle de spectacle au coin de la 2ième rue et de la 3ième avenue de l'Alphabet City, au milieu des onze musiciens et de leurs instruments qui occupent toute la scène, l'élan spirituel vous prend et dans un concentré de sons ne vous quitte plus. Ce n'est pas un spirituel de contemplation mais d'explosion extatique qui se nourrit du centrifuge et de l'excentrique. Même si New-York ne vit plus de l'explosion créatrice qu'elle a connue dans l'univers déjanté des bars underground et de la culture frivole des années soixante-dix et quatre-vingt, même si certaines atmosphères décadentes dans lesquelles Nans Goldin nous fait entrer par ses photographies appartiennent bien à un passé révolu de la ville, du spirituel sommeille toujours en elle. C'est pourquoi certains ont pu avancer qu'au delà de la ville d'art, New-York, par sa genèse, son inventivité et ses audaces, était en elle-même une oeuvre d'art c'est à dire un délire.
Merci Thierry (mai 2014)